2. CULTURE POPULAIRE : MAIS QU'EST-CE A DIRE ?
Culture populaire : mais qu’est-ce à dire ?
mars 2011
(le texte en pdf est téléchargeable en bas de cette page)
Lawrence W. Levine, historien américain, né en 1933 et mort en 2006, a marqué l’histoire culturelle américaine à deux reprises, par son livre sur la conscience noire en 1977 (Black Culture and Black Consciousness) et par son livre sur la culture populaire en 1988. Ce dernier, Culture d’en haut, culture d’en bas, l’émergence des hiérarchies culturelles aux Etats-Unis, a été publié en français l’an dernier, aux Editions de la Découverte (1). Ce livre est un recueil de trois articles, dont l’éditeur dit qu’ils sont une référence outre-Atlantique. Le premier texte vient d’une conférence prononcée en 1984, intitulée « William Shakespeare en Amérique », qui énonce que la culture aux Etats-Unis aurait connu une « transformation culturelle » entre le milieu du XIXème siècle et le premier XXème siècle, au cours de laquelle les objets d’une « culture publique partagée » auraient été confisqués par les classes sociales supérieures, ce qu’illustrerait l’évolution des emplois et de la réception de l’oeuvre de William Shakespeare. A une culture authentiquement populaire et commune aurait succédé un usage socialement discriminant des objets culturels, distribués entre « highbrow » et « lowbrow », « front haut » et « front bas » (2). Au moment où vient d’être jetée sur le marché médiatico-politicien l’expression de « culture pour chacun » (3), l’analyse de ces textes de Lawrence W. Levine peut être éclairante car elle permet de traverser les points nodaux de la question de la « culture » en tant que projet politique, projet dont la notion de « culture populaire » constitue une pierre de touche. Et d’aborder ainsi, de revers, quelques éléments de cette nouvelle affaire de la « CPC ».
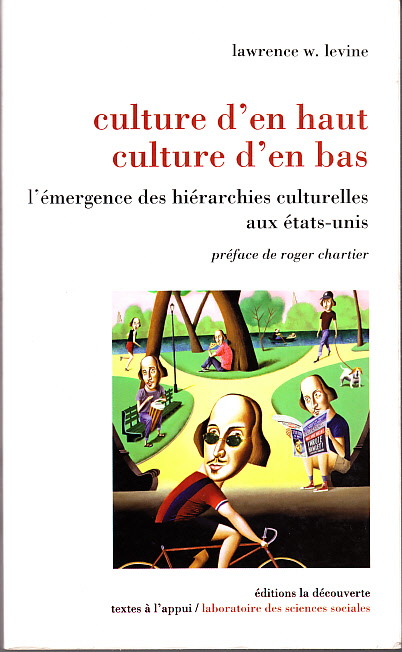
1.
Décrivons dans un premier temps ce que dit Levine : le XIXème siècle aurait été le temps d’une mutation culturelle profonde aux Etats-Unis, passés d’une « culture publique partagée » - l’expression revient souvent - à une organisation de la culture en catégories rigides et socialement exclusives. La comparaison des usages du théâtre, et en particulier d’une salle de spectacle, d’un bout à l’autre du siècle est étonnante. Quatre traits émergent du texte de Levine pour caractériser ce qui aurait été une authentique culture populaire.
Première caractéristique, le théâtre dans les Etats-Unis de la première partie du XIXème siècle, est un moment de divertissement collectif prisé de tous. Ainsi, à San Francisco, le Jenny Lind Theatre en 1850, ouvert au dessus d’un saloon, contenait 2000 places et faisait constamment salle comble : « Les mineurs (…) arrivaient en masse des tripots et des salles miteuses où l’on dansait le fandango pour voir Hamlet et le Roi Lear. » (4). La situation est à l’inverse de la nôtre au début du XXIème siècle : les théâtres actuels déploient des trésors d’invention publicitaire pour faire venir du « public », tandis que les Etats-Unis d’il y a deux cent ans connaissaient plutôt une pénurie de théâtres, notamment dans les régions les moins équipées, à l’Ouest et dans les petites villes du territoire. Aussi fabriquait-on des scènes là où c’était possible : des planches posées sur deux tables de billards au deuxième étages d’un entrepôt de tissu à Downieville, dans la Sierra ; la salle du deuxième étage d’une ancienne brasserie à Lexington dans le Kentucky ; la salle à manger d’un hôtel de Tazewell en Alabama, etc. Le théâtre comme phénomène social débordait donc en permanence les moyens des équipements. Levine : « Tout comme l’église, le théâtre était l’une des premières institutions culturelles mises en place dans les villes de la Frontière et l’une des plus importantes » (5).
La seconde caractéristique de cette séquence culturelle est la familiarité partagée avec des objets qui sont aujourd’hui affectés d’une « distinction » (6). Ainsi, sur les deux tables de billards de l’entrepôt, on joua Richard III (c’était dans les années 1850), dans l’ancienne brasserie, on joua La Mégère apprivoisée, Othello et Le Marchand de Venise (1816), et dans la salle à manger de Tazewell en 1833, la troupe de Sol Smith tenta, entre autres, de déclamer la tirade des « sept âges de l’homme » de Comme il vous plaira (7). C’est le fer de lance de l’argumentaire de Levine, la preuve au sens quasi juridique de son texte : l’omniprésence de Shakespeare dans la culture américaine du XIXème siècle. Shakespeare était un creuset culturel commun, une sorte d’équivalent profane de la Bible. « Shakespeare n’était pas joué en marge des divertissements populaires, comme un supplément réservé aux élites ; il en faisait partie. Dans l’Amérique du XIXème siècle, Shakespeare était un divertissement populaire. » (8) Appris par coeur comme matériel naturel des manuels scolaires, joué par des soldats d’infanterie au Texas pendant la Guerre du Mexique, cité incessamment par les politiciens dans leurs discours, Shakespeare était une portion majeure du socle culturel américain au XIXème siècle (9). A partir de quoi Levine déduit que la culture américaine de cette époque était moins hiérarchisée, moins clivée qu’elle ne l’est devenue par la suite.
Les troisième et quatrième caractéristiques de cette configuration culturelle américaine nous obligent pourtant, il me semble, à nuancer cette affirmation. La première concerne la nature des spectacles de l’époque, objets hybrides qui correspondent à une période culturelle d’avant les loisirs et la diversification des activités et la spécification des objets qu’ils ont induit. Ainsi, de la même manière que les musées présentaient ensemble objets de curiosité scientifique, oeuvres d’art, moulages, voire petits numéros de musique ou de cabaret (des nains chantant ou des vaches à deux queues et cinq pattes, par exemple (10)), de la même façon les spectacles de la première moitié du siècle étaient des composites fondés sur le double principe du cabaret et du best-off, à savoir 1) la multiplicité et 2) la compilation. 1) Une soirée type était constituée « d’une longue pièce, d’une deuxième partie (en général une farce) et d’une série d’interludes. » (11) Ainsi, au Théâtre américain de Philadelphie en 1839, une soirée proposait-elle Comme il vous plaira de notre auteur fétiche, suivis de numéros de gymnastique, de chansons, de petits numéros de danse, d’une « histoire yankee » et pour finir d’une autre pièce (12). 2) Shakespeare certes était abondamment au programme, mais ses pièces étaient en réalité le plus souvent modifiées : elles faisaient l’objet d’adaptations qui consistaient à couper certains passages, à en aménager d’autres, en général pour ne conserver que les parties les plus célèbres et prisés, ou pour complaire aux goûts patriotiques du public et à sa moralité pointilleuse. On édulcorait un peu, par exemple, la violence verbale de Hamlet contre sa mère ; de même, il était préférable de dire que Juliette avait dix-huit ans et non pas treize… Dans l’ensemble, ce n’était pas Shakespeare qui était joué, mais des réécritures de ses pièces par des auteurs américains. Le rapport à Shakespeare – et aux autres « auteurs », que ce soit au théâtre ou à l’opéra - n’était pas un rapport à l’oeuvre – notion plus tardive - mais au matériau. L’écart qui sépare deux représentations de Shakespeare, l’une dans la France des années 1980 et l’autre dans le Far West des années 1830 est de taille : s’y donne en effet une même continuité de signifiants – les titres des pièces et le nom de l’auteur sont les mêmes - , mais sans continuité d’objets – la structure de l’objet et la relation à lui n’ont rien à voir. C’est pourquoi il ne me paraît pas justifié de dire, comme le fait Levine : « Nous avons tendance à oublier facilement l’idée selon laquelle les mêmes formes de culture peuvent remplir des fonctions manifestement différentes dans des périodes ou des groupes différents» (13), puisqu’il ne s’agit pas, précisément, des mêmes « formes de culture ». Il y a une naïveté à réduire la culture à une affaire de signifiants (Shakespeare or not Shakespeare ?), alors que le livre de Levine nous montre à la lettre qu’un même nom peut recouvrir des usages culturels diamétralement opposés.
Le quatrième élément achève à mon sens de rendre impossible l’idéalisation de cette séquence culturelle américaine pré-loisirs et finit d’arracher cette question à l’ambiance morale dans laquelle Levine a tendance à faire baigner les choses, pour nous obliger à prendre la mesure de mutations anthropologiques dont la culture a pris les formes mais dont elle n’est pas la cause. En fait de culture populaire ouverte, « partagée » et « fluide », le théâtre américain du premier XIXème siècle ressemble à ce qu’étaient les théâtres en France au XVIIIème siècle, et, à suivre Levine, aux stades de foot actuels : un espace d’intolérances, de caprices collectifs et de violence. « Un bon moyen de se faire une idée précise de qu’était le public des théâtres du XIXème siècle serait d’assister à un événement sportif aujourd’hui, dont le public non seulement est tout aussi hétérogène, mais – comme à l’époque élisabéthaine et au XIXème siècle – n’est pas un simple public ; les spectateurs sont des participants (…) » (14). La comparaison de Levine est peut-être vraie au-delà de ce qu’il souhaiterait, car en effet, xénophobie, sexisme et violence semblent avoir été les paramètres des jugement de ce public. Globalement les représentations avaient lieu dans le brouhaha, les cris, les coups de pieds sur le plancher et en pleine lumière (ce n’est que tardivement que silence, noir et applaudissements seront les coordonnées naturelles de l’audience, comme outils d’ailleurs d’un vaste mouvement de mise au pas du public). Trois exemples pour le plaisir croustillant de leur exotisme : 1) une représentation de Henri V au Chestnut Theatre Street de Philadelphie en1808 s’acheva en émeute parce qu’une réplique de Henri (« Il me semblait que sur deux jambes anglaises / Marchaient trois Français ») fut interprétée comme de la propagande pour l’Angleterre aristocratique contre la France révolutionnaire (15). (La question du modèle anglais, et plus largement européen, c’est-à-dire la question coloniale, est structurante pour comprendre la culture américaine de cette période – le traité de Paris, qui consacre la souveraineté et la naissance des Etats-Unis, date de 1783.) 2) En 1831, le chanteur anglais J.R. Anderson, soupçonné d’avoir parlé en mal des Américains en Europe, fut plusieurs soirs de suite dans l’impossibilité totale de jouer au Park Theatre de New York, face aux cris et aux projections de pommes, d’oeufs et de divers autres fruits et légumes. Des bagarres se produisirent ensuite entre pro et anti-Anderson, et le public furieux ne fut apaisé que lorsque les jours suivants la façade du théâtre fut couverte d’insignes patriotiques, d’aigles et de drapeaux. 3) Le dernier exemple est moins drôle, il s’agit du « Jeudi sanglant » de mai 1849 autour de l’opéra de l’Astor Place de New York, au cours duquel l’opposition entre deux acteurs, l’un anglais, l’autre américain, incarnant chacun des valeurs opposées, aristocratie et intellectualité contre virilité patriotique, fut l’alibi du vandalisme du théâtre où chantait l’Anglais et d’une répression par la réserve territoriale qui fit vingt-deux morts et plus de cent cinquante blessés. Où l’on déduira qu’en fait d’aménité des opinions, de partage et d’ouverture d’esprit, le paradigme de la « culture populaire » devra se trouver d’autres exemples de prédilection que ceux du théâtre américain du XIXème siècle… Sauf à reconnaître ses parts refoulées.
Quatre caractéristiques donc de ce théâtre : 1) importance symbolique majeure du théâtre dans la société américaine après l’Indépendance – le mot de « popularité » serait-il pertinent ? ; 2) spécificité des objets de cette séquence culturelle ; 3) plutôt qu’une absence de hiérarchie des objets, une singularité américaine des critères hiérarchisants ; 4) enfin une omniprésence de la violence, tenant à la haute charge symbolique des événements scéniques et à des modalités de rapport à la violence historiquement spécifiques.
2.
En vérité, parce que des mineurs de Californie connaissaient des tirades de Shakespeare par coeur, Levine idéalise la culture et le rapport à la culture de cette période – au nom d’ailleurs d’une valorisation ultérieure du signifiant « Shakespeare » qui le classera parmi les objets de la culture légitime, lors même que Levine condamne cette « expropriation » - , et il est clair que l’interprétation historique est ici chargée d’enjeux. N’y a-t-il pas un biais idéologique marqué dans cet imaginaire saint-sulpicien qui consiste en une pastorale culturelle, à ce point fantasmatique qu’on est prêt à faire passer des lynchages d’acteurs à coup de fruits pourris, des théâtres vandalisés, des principes de foire, le nationalisme, la xénophobie et le sexisme les plus agressifs pour l’âge d’or à jamais perdu de la démocratie culturelle, et partant, de la démocratie tout court ? Quel mépris social tapi s’alimente à ces visions de patronage ? N’y a-t-il pas dans ce désir de constituer une séquence historique en âge d’or de la culture, subsumée sous cette expression on-ne-peut-plus idéologique de « culture populaire », un pur fantasme ? Les usages culturels que décrit Levine ne sont ni pacifiques, ni souples, ni dépourvus de hiérarchies et de classements, comme son sous-titre le prétend (« L’émergence des hiérarchies culturelles aux Etats-Unis »), ils correspondent prioritairement à une
période historique où le rapport entre culture et société n’était pas structuré de la même manière. Ce qui reste donc à creuser.
Les caractéristiques de cette « culture publique partagée » qu’identifie Levine en ce premier XIXème siècle américain auraient été l’absence de hiérarchie et de séparation, hiérarchie des objets et des classes sociales, séparation entre l’art et ce qu’il n’est pas. A examiner ses exemples, on s’aperçoit que c’est faux, puisque le public était absolument intolérant et jugeait de la valeur de ce qui lui était proposé à l’aulne de l’image qu’il entendait que l’objet lui renvoie de lui-même, celle d’une nation indépendante, virile et fidèle à ses préceptes religieux. D’autre part, indépendamment de la validité de l’affirmation, que se joue-t-il dans cet amour pour une culture dont on prétend qu’elle serait finalement « sans jugement », sans exigences, brassant le pur et l’impur sans hiérarchie (la rhétorique culturelle américaine, imprégnée d’esprit quaker, est très polarisée par la notion de pureté) ?
Il me semble que cette notion de « culture populaire » renvoie au désir d’une triple innocence, innocence des objets, innocence des sujets, et innocence de la société, en quoi il me semble légitime de la qualifier de fantasme. 1) Levine insiste sur le caractère brassé et sans classement des spectacles auxquels les Américains assistaient. On a vu que c’était une illusion : le rapport au divertissement était excessivement distribué selon les critères qui organisaient l’imaginaire national américain d’alors. Pourtant la culture dite populaire se donne ainsi à imaginer comme un monde d’avant le jugement de goût, ou hors jugement de goût, c’est-à-dire avant ou hors ces deux phénomènes distincts que sont l’exigence artistique et le mépris de classe, dont la culture est en effet une scène privilégiée. (Mais pourquoi dénoncer l’autre serait-il se débarrasser de l’un ?) Le rapport aux objets aurait été, dans cet Eden culturel, un rapport d’immédiateté bienheureuse. On en aurait joui sans entraves. 2) La notion de culture populaire postule en outre une innocence idéologique, elle suppose un lieu où les déterminations sociales seraient suspendues, annihilées, un endroit hors politique, où les individus baigneraient dans la même communion entre eux qu’avec des objets, sans jugements et sans hiérarchie. Là où les classes dominantes sont accusées par Levine d’user de la culture comme d’un levier de pouvoir, le rapport des classes sociales dominées à la culture ne fait jamais l’objet d’un examen rigoureux, au point qu’il finit par définir un espace implicite d’innocence, de naïveté sociale, pour tout dire de bonté. John Philip Sousa, compositeur et chef d’orchestre américain, fervent défenseur du divertissement « populaire » et hostile à la culture highbrow, a défendu ainsi ses choix : « Les gens qui fréquentent mes concerts sont ceux qui sont forts et en bonne santé. Je veux dire sains de corps et d’esprit. Ces gens aiment la musique virile. Vous ne verrez jamais dans mon public d’homme aux cheveux longs ni de femmes aux cheveux courts. Et je n’en veux pas. » (16). Cette citation prouve qu’il n’y a pas de divertissement innocent, tout objet a des coordonnées idéologiques, même, voire précisément, quand c’est au nom d’un mot aussi glissant que celui de « populaire » que l’on prétend agir. Curieusement le sexisme et l’homophobie de Sousa trouvent chez Levine des condamnations assez molles, en quoi notre auteur m’apparaît représentatif de cette dynamique d’idéalisation des classes populaires. Où l’on entrevoit que la culture populaire comme catégorie serait en fait une catégorie de la culture savante. 3) N’y aurait-il pas, en dernier ressort, derrière le vocable de culture populaire, la volonté, réactionnaire au sens premier du terme, de (re)trouver une société d’avant la réflexivité moderne ? C’est-à-dire avant une certaine modalité d’inscription des sociétés dans l’histoire, un certain mode de représentation des sociétés par elles-mêmes comme inscrites dans une histoire.
Il ne s’agit pas de dire que quelque chose comme une ou de la culture populaire n’existerait pas - est-ce un type d’objets, une nature de rapport à l’objet, des séquences historiques ? Il s’agit de voir que telle que Levine la décrit, la culture populaire n’existe pas. En tant que lieu pur, la culture populaire est une mythologie. C’est pourquoi je proposerais d’interpréter la culture populaire en tant que lieu d’innocence idéologique comme l’équivalent, du point de vue culturel, de l’état de nature pour la modernité politique. Une fiction qui n’est opératoire qu’en tant que telle et dont le péché originel des politiques culturelles aurait été et serait de croire en la possible réalité / réalisation. Il n’y a pas d’endroit où la détermination sociale serait suspendue, gelée, sans effets, pas d’objet qui ne soit inscrit dans une cartographie sociale donnée. Pour parler comme Slavoj Zizek, on pourrait formuler cela ainsi : la lutte des classes appartient au réel, elle est une dimension incompressible de l’expérience humaine, une forme vide structurante de l’existence sociale. La culture populaire, en tant que mode de rapport collectif où les déterminations sociales seraient suspendues, n’existe pas, elle est le fantasme d’un monde hors société, d’un lieu pur, où tous les objets seraient bons. Ce qui n’interdit pas dans un second temps de saisir ce qu’il y a d’anti-intellectualisme dans cette mythologie et je pose l’hypothèse que la dénonciation du snobisme culturel n’est jamais si virulente que pour se débarrasser de l’exigence artistique. Il n’y a jamais eu d’espace-temps où les objets et les individus n’étaient pris dans des dynamiques de distinction et où, précisément, les objets de la culture venaient proposer leur miroir, leur espace d’identification sociale. Que la culture ait ajouté une autre scène à l’expression des antagonismes sociaux ne saurait la tenir responsable des antagonismes eux-mêmes. Le livre de Levine fourmille d’exemples et d’anecdotes qui démontent sa propre thèse : pas une réplique de Shakespeare, pas un petit air de bel canto auxquels on ne demandât qu’ils disent la force des Américains, leur valeur morale, leur vaillance, leur vigueur, bla bla.
Deux des articles de ce livre proviennent de conférences dont l’intitulé initial était « La fragmentation de la culture américaine », ce qui sous entend que la culture américaine aurait connu une forme d’unité antérieure, par la suite brisée. N’est-ce pas là un titre significatif de cette représentation d’une culture une et non-divisée qui aurait été celle des premiers Etats-Unis, et qui renvoie au fantasme d’un corps politique uni et sans scissions ? Mais était-ce bien le cas ? Les exemples de Levine ne nous montrent-ils pas au contraire une société sans cesse déchirée par des lignes de partage sociales et idéologiques très fortes et dans le bouleversement continu d’une nation important massivement de la main d’oeuvre européenne sans les moyens de l’accueillir correctement ? Le film Gangs of New-York (2002) de Martin Scorcese a pour cadre les émeutes à New York en 1862,
épisode historique qui témoigne de la violence de cette société, entre la fin de la guerre d’indépendance et le début de la guerre de Sécession, et dont on peinerait à dire, en effet, qu’elle était culturellement unifiée, si tant est que cette notion ait un sens.
Résumons : la notion de culture populaire emporte trois innocences, une innocence des objets, une innocence des sujets, et un fantasme de société pré-moderne, c’est-à-dire une immédiateté culturelle, une bonté sociale, une société hors histoire, un monde où tous les objets ont la même valeur et où les êtres ne sont plus situés socialement. Le théâtre américain dit populaire du premier XIXème siècle montre combien la surdétermination des données religieuses et politiques, c’est-à-dire coloniales, sociales et sexuelles, était prégnante et combien, à ce titre, la culture populaire, appliquée à cette scène historique, est une mythologie.
3.
Car c’est au nom de ce modèle imaginaire de la culture populaire que le rapport réel à la culture est jugé et c’est à une fonction d’horizon que ce modèle est placé. Dire qu’en tant que représentation d’une unité sociale perdue, la notion de culture populaire n’existe que comme fantasme, ne résout pas la question de ce que doit être la « culture » en tant que projet collectif.
Si le socle imaginaire sur lequel Levine s’appuie pour dénoncer la « confiscation » culturelle aux Etats-Unis au XIXème siècle me semble contestable, il a néanmoins raison de pointer les nombreuses situations où le (contrôle et la production du) goût sont un outil du pouvoir et où la culture est instrumentalisée par l’ordre dominant pour naturaliser et justifier sa domination. (Les actuelles émissions de télévision sur la décoration des maisons et des appartements, « Les maçons du coeur », émission québécoise sur TMC, « D&co » sur M6 par exemple, participent de cet esprit de normalisation du goût.) Le vaste mouvement de structuration culturelle des villes américaines dans la seconde moitié du XIXème siècle – création de musées, de parcs publics, d’événements musicaux – est explicitement destiné à domestiquer les travailleurs et à leur fournir des occupations qui les éloignent de la politique. Où la notion de divertissement – ce qui détourne – trouve en sa vérité étymologique une violence sociale inattendue… Une auteur catholique américaine du tournant du siècle dernier, Louisa Cragin « soutenait que si l’on transformait les syndicats en sociétés chorales et si l’on offrait de la bonne musique aux travailleurs et à leurs enfants, en une génération, « il y aurait moins de grèves, les visages crasseux seraient moins hagards ; sous l’influence inconsciente de la beauté, de l’harmonie et du rythme, le travail serait effectué avec plus d’enthousiasme et de loyauté. » » (17) .N’est-ce pas là une citation extraordinaire qui dit, avec une franchise obscène, l’usage réel de la culture comme lubrifiant de l’exploitation capitaliste ? Et quelle est la vertu inconsciente de la beauté sur les élites économiques ? Pourquoi ne se propose-t-on jamais d’aller faire l’éducation des couches sociales dominantes ? (C’est là aussi l’erreur de Levine que d’accuser la culture de
hiérarchisations indues et instrumentalisées, au lieu d’aller cueillir directement à la source le désir de hiérarchie sociale, quelle qu’en soient les scènes, culturelles ou autres.)
Or la démocratie culturelle, c’est casser l’équivalence posée comme naturelle entre l’art et le capital - capital entendu dans toutes ses acceptions sociologiques (social, économique, culturel) (18). Ce qui ne veut pas dire croire en la possible suspension des effets du capital. Mais c’est commencer par dénaturaliser des représentations que l’on prétend combattre mais que l’on consolide en les nommant. C’est d’abord remettre en cause la double équation ‘riches = culture savante, pauvres = culture populaire’, d’abord parce qu’elle est fausse, ensuite parce que son énoncé produit le contraire de ce que le discours dans lequel il est habituellement pris prétend dire. Il n’y a aucune naturalité de relation entre les classes supérieures et l’art, il n’y a, en la matière, qu’une inertie d’effets de discours qui imposent cette illusion. L’art serait ce qui nous requiert en tant que sujets, c’est-à-dire que rien, in fine, ne nous prémunit contre la force de ses propositions, nous sommes tous démunis, ou pour le dire autrement, face à ce qu’est l’art en tant que tel, il n’y a pas de capital qui vaille comme pont, comme clef, comme domestication.
J’invite mes lecteurs à se rendre, par exemple, aux Bouffes parisiens, dans la partie « carré or » du parterre et à constater combien la bourgeoisie parisienne de droite est émoustillée – de façon absolument attendrissante du reste – par les objets les plus populaires qui soient – en l’espèce Alain Delon et sa fille dans Une journée ordinaire (19). Je passe avec magnanimité sur l’inespéré exemple de la récente fortune de La Princesse de Clèves, exemple édifiant du devenir contemporain des rapports du pouvoir et du savoir, pour inviter à s’amuser des références au cinéma que l’on dit savant – Ingmar Bergman, Luchino Visconti pour commencer - dans les clips de Lady Gaga, objet archétypal de la culture de masse actuelle. Les portions et les termes de cette double équation ne tiennent pas et je prétends que son postulat n’a d’enjeu véritable que la consolidation de l’ordre social ségrégationniste qu’elle aurait pour fonction de mettre à bas.
Or l’objet de la démocratie culturelle est de redistribuer la donne. La démocratie culturelle, c’est commencer par affirmer cela, que l’art appartient en droit à tous, et qu’appartient en droit à tous le droit à un rapport élevé aux objets de la culture. Casser la naturalisation des hiérarchies signifie donc décorréler distinction des objets et hiérarchies sociales. Il n’y a aucune raison de penser qu’être médecin vaille mieux qu’être femme de ménage en soi. Et conséquemment, pas non plus de raison de penser que leurs habituels écarts de revenus soient légitimes, même s’ils sont légaux ou avalisés par la société. En revanche, il peut être tout à fait intéressant d’observer que les objets de la culture ne s’adressent pas à nous de la même manière et nous proposent des modes de rapports distincts les uns des autres. Autrement dit, des régimes de plaisirs spécifiques. Une chanson de Mina, un texte de Samuel Beckett, un spectacle de Christoph Marthaler, un film de Georges Romero, un spectacle de Maguy Marin ne nous proposent pas la même chose. (Où l’on déduira de cette apparente lapalissade que le ‘public’ est une chose qui n’existe pas, la seule chose qui existe étant les modes d’adresse.) Un clip de Mina à la Rai (télévision italienne) dans les années 1970 et une chanson de Mina dans un spectacle de David Marton en 2011 à la MC93 de Bobigny nous proposent-ils le même corps d’expériences (20) ? Une chanson de Dalida, nécessairement estampillé « culture populaire », dans un spectacle de Raimund Hogue, quid ? Où l’on a d’ailleurs affaire de nouveau à quelque chose comme un mélange… C’est une vraie question, qui ne contient pas déjà sa réponse.
Rabattre les objets culturels et le rapport que nous avons à eux sur des choix de classe a une limite, celle des objets eux-mêmes, qui nous obligent à nous interroger autrement, non pas en termes de haute et basse classe sociale, mais en terme de haute et basse adresse, de valeur artistique elle-même. Ces rares exemples sont donnés pour nous inciter à affranchir le rapport aux objets de la culture de l’équation stérilisante « culture d’en haut, culture d’en bas », qui a pour double effet de naturaliser les hiérarchies sociales – et pourquoi donc ? – et de paralyser toute dynamique de distinction des objets de la culture en fonction de leurs vertus propres, puisqu’elles seraient nécessairement rabattables sur des choix de classe. Ce texte plaide au contraire pour la nécessité d’une remise en cause radicale des distinctions sociales – pour une repolitisation de la politique, pour le dire autrement - et pour une exacerbation du goût de la distinction des objets en matière d’art et de culture. Le discours de promotion de la « culture populaire » supporte un fantasme d’indistinction des objets – ah ! ces compilations de bel canto entrecoupées de chansons patriotiques et de numéros de musculation… - et d’une dénonciation des appropriations sociales des valeurs culturelles, mais n’est-ce pas là une inversion formidable ? Ne devrions-nous pas lutter pour l’égalité statutaire des individus dans la société et ne promouvoir émulation et concurrence que sur le plan artistique et intellectuel ? Ce qui ne veut pas dire être dans le déni de la cartographie sociale, s’affranchir n’est pas dénier, c’est dépasser. Il faut parvenir à penser ensemble la singularité des expériences culturelles, et la hiérarchie qu’elle emporte, d’une part, et d’autre part la rupture avec des hiérarchies indues et naturalisées.
On pourrait formuler cela autrement : la culture, ce serait finalement se demander ce que signifie ‘bien aimer’. Non pas dans le sens d’aimer un peu, mais dans le sens d’aimer d’une bonne façon. La culture induit une notion de hiérarchie, une idée d’élévation, de transformation. Le préjudice commence lorsqu’on naturalise des chaînes de hiérarchies. C’est pourquoi il ne serait pas pertinent que les politiques culturelles continuent d’ordonner leur action au verbe ‘aimer’, sur le mode implicite du « dis-moi ce que tu aimes et je te dirais d’où tu viens et où tu es ». En conséquence de quoi, il faudrait aimer telle ou telle chose, il faudrait ‘fréquenter’, de gré ou de force, pour se sentir appartenir à la nation ou à la classe que l’on veut. Mais le livre ne Levine ne nous apprend-il pas finalement que le verbe aimer ordonné à la culture ne dit rien ? Les Américains aimaient Shakespeare : ne serait-ce pas là l’énoncé le plus faible que l’on puisse produire, au regard de la complexité de la réalité culturelle que Levine décrit avec détails ? L’option forte à adopter en matière de culture s’attacherait alors non pas à la question d’aimer mais à la notion de ‘bien aimer’. Ce qui permet de mettre l’accent non pas sur la ’fréquentation’ des objets, non plus sur le tri entre bons et mauvais objets, mais sur la nature de cette fréquentation, option bien plus démocratique dans le sens où les effets de classe sont remis en jeu différemment. C’est-à-dire que la question serait non pas ‘qu’est-ce que tu aimes ?’, mais ‘comment aimes-tu ?’, et ’qu’est-ce que tu y aimes ?’ et ‘quand aimes-tu ?’, etc. (Autant de paramètres de rapport à l’objet qui échappent d’ailleurs aux critères d’évaluation de la sociologie culturelle dominante actuelle.)
notes
(1) Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marianne Woollven et Olivier Vanhée, préface de Roger Chartier, collection textes à l’appui, série « laboratoire des sciences sociales », dirigée par Bernard Lahire, 2010. Le titre original est Highbrow / Lowbrow. The emergence of Cultural Hierarchy in America, Harvard University Press, 1988.
(2) Highbrow et lowbrow sont des termes de phrénologie, théorie scientifique de la fin du XIXème siècle, invalidée aujourd’hui, qui attribuait des caractères aux différentes formes des crânes.
(3) Depuis septembre 2010, le Ministère de la Culture et de la Communication a annoncé le remplacement de l’expression socle de « culture pour tous » par celle de « culture pour chacun ». Un rapport rédigé par les conseillers Guillaume Pfister et Francis Lacloche, disponible sur le net, fait l’objet de rencontres organisées en régions.
(4) Levine, p. 31.
(5) Levine, p. 30.
(6) La méthode de travail de Levine n’est pas sans homologies avec son idéal culturel : il travaille presque exclusivement avec des sources « directes », élaborant excessivement peu avec la théorie. On sera tout de même étonné de l’absence totale de référence à son contemporain Pierre Bourdieu sur des questions qu’ils partagent (La distinction, critique sociale du jugement date de 1979).
(7) Levine, p. 32.
(8) Levine, p. 34.
(9) Levine dit que l’Amérique lisait dans l’oeuvre de Shakespeare le reflet de sa propre idéologie, une « morale de la responsabilité individuelle ». Les descriptions de Levine montrent du moins combien on s’arrangeait pour faire entrer Shakespeare dans le lit de Procuste des exigences du nationalisme américain. Voir p. 55 et suivantes.
(10) Levine, p. 156 et suiv.
(11) Levine, p. 34.
(12) Le mélange serait ainsi comme au principe d’une forme de « culture populaire », là où peut-être en revanche la notion d’interdisciplinarité viendrait caractériser des formes plus « bourgeoises ».
(13) Levine, p. 251.
(14) Levine, p. 40.
(15) Levine, p. 74.
(16) Levine, p. 248.
(17) Levine, p. 211.
(18) Peut-être devra-on, dans un second temps qui prolongerait ce texte, compléter cet énoncé d’une mise au point sur les différences entre démocratie culturelle et démocratisation culturelle.
(19) Texte de Eric Assous, mise en scène de Jean-Luc Moreau.
(20) Dans Harmonia Caelestis, spectacle de théâtre musical présenté par une équipe autrichienne dans le cadre du festival du Standart idéal à Bobigny en février 2011, une des comédiennes chanteuse interprète « Se telefonando », une chanson de Mina, chanteuse officielle de la Rai dans les années 1960.
